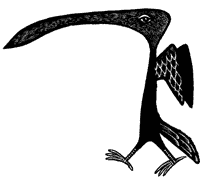




Un livre fait office de bibliographie complète, par son exhaustivité [1540 pages], son prix [27,44 euros], et la justesse de son approche transversale [80 documents, mélange pluridisciplinaire d’articles d’auteurs contemporains et d’extraits des textes fondateurs sur les rapports entre l’homme et l’animal] : Boris Cyrulnik (dir.), Si les lions pouvaient parler. Essais sur la condition animale, Gallimard Quarto, 1998. Les appels de note en lettres renvoient à des articles inclus dans cet ouvrage.
a. Bernard Denis, « La fabrication des animaux ».
b. Jean-Pierre Digard, « La compagnie de l’animal ».
c. Boris Cyrulnik, « Les animaux humanisés ».
d. Claude Fischler, « Le comestible et l’animalité ».
e. Françoise Armengaud, « Au titre du sacrifice : l’exploitation économique, symbolique et idéologique des animaux ».
f. Boris Cyrulnik, « L’empêchement de l’inceste ».
g. Dominique Lestel, « Les singes parlent-ils vraiment ? ».
h. Henri Ellenberger, « Jardin zoologique et hôpital psychiatrique ».
i. Robert Delort, « Les abeilles ».
1. On crée des formes naines d’animaux
par sélection continue, i.e. tout simplement en croisant des
animaux de petite taille entre eux ; cf. (a) in bibliographie. [Retour
au texte]
2. Un ami végétalien... Plus
radicaux que les végétariens qui ne refusent que la chair animale,
les végétaliens refusent toute nourriture d’origine animale,
ainsi les œufs, le lait, le miel. [Retour
au texte]
3. Descartes, Lettre à Morus (5
février 1649), in Œuvres et lettres, Gallimard, Pléiade,
1953. [Retour
au texte]
4. Lévitique, 11.21, nouvelle
traduction de Marie Borel, Jacques Roubaud & Jean L’Hour, Bayard, 2001. [Retour
au texte]
5. Georges Bataille, 1953, in Œuvres, Gallimard, 1976. [Retour
au texte]
6. Cf. M.Detienne & J.-P.Vernant,
La cuisine du sacrifice en pays grec, Gallimard, 1979. [Retour
au texte]
7. Postface à Peter Singer, L’égalité
animale expliquée aux humains, tahin party, 2000. Cf. l’article
« Nature (1) ». [Retour
au texte]
8. Witold Gombrowicz, Journal, Gallimard,
Folio, 1996. [Retour
au texte]
9. Programme de Jean-Marie Le Pen, présidentielles
2002. [Retour
au texte]
10. É. de Fontenay, « La raison
du plus fort », préface à Plutarque, Trois traités
sur les animaux, Ier siècle, p.o.l., 1992. [Retour
au texte]
11. La Ménagerie de Versailles, créée
par Louis XIV en 1662, fut détruite pendant la Révolution ;
un établissement public, la Ménagerie nationale du Jardin des
Plantes, fut reconstruit. [Retour
au texte]
12. Georges Bataille, Théorie de
la religion. Œuvres, t.VII, Gallimard, 1976. [Retour
au texte]
13. Montaigne, Essais, II.XII, «
Apologie de Raymond Sebond », 1588. [Retour
au texte]
14. Aristote, Parties des animaux,
I, 644b. [Retour
au texte]
Dieu a créé le chien. L’homme a créé le bouledogue, le chihuahua et le lévrier afghan. Dieu a créé la vache. L’homme a créé Prunelle, 1235 kilos, médaille d’or du Salon de l’agriculture. Qui est le plus doué, c’est ce qu’on voudrait savoir.
Vous qui chérissez votre basset-hound et l’emmenez régulièrement chez le vétérinaire, il est temps de regarder la vérité en face. Votre basset est très malade. Votre basset souffre de « nanisme chondrodystrophique »[a]. Votre basset, que vous nourrissez de croquettes aux 7 vitamines, n’est devenu basset que par le biais d’une nourriture déséquilibrée visant à bloquer la croissance de ses pattes[1]. Dieu n’avait pas prévu qu’un jour ses oreilles traîneraient par terre. Dieu n’avait pas voulu une chose pareille. L’homme, oui : « Il n’y a aucune raison, compte tenu du rôle que joue l’esthétique du chien, [...] de se priver de la possibilité de choisir certaines races »[a]. Le chienchien à sa mémère, conçu petit pour rentrer dans un sac à main et éviter l’amende, aboyant aigu pour rappeler le cri d’un enfant de substitution, yeux exorbités pour susciter l’affection, est apprécié depuis des millénaires, tout comme les animaux sauvages apprivoisés et rendus dépendants de l’homme. César s’écrie : « les femmes romaines n’ont-elles donc plus comme autrefois des enfants à nourrir et à porter dans les bras ? Je ne vois partout que des chiens et des singes. » [b] Les animaux de compagnie ne sont pas une tare de la société moderne ni même occidentale. Ça marche depuis toujours, l’anthropomorphisme.
On laisse à d’autres l’éloge du démaquillage et le mythe du bon sauvage. Faudrait-il « une modification des pratiques de jugement dans les expositions, car elles favorisent trop souvent les hypertypes »[a] ? Votre basset est un hypertype. Votre basset se trouve beau, même s’il a fallu souffrir pour l’être. Votre basset est artificiel, voire superficiel. Votre basset est un produit culturel : naturel mis au goût humain. Si votre jardin a le droit de ressembler à un Corot, on ne voit pas pourquoi votre dalmatien n’aurait pas le droit de ressembler à un zèbre. L’émulation nature-culture est éternelle ; et l’art est un bon professeur : les dalmatiens ne font pas tache dans l’immensité de la création, et le teckel qui traîne par terre finira peut-être par ressembler au serpent. L’homme ne peut pas s’empêcher de tailler les arbres, de corseter les femmes, d’inventer la nectarine et le lapin fluo : faut-il lui attacher les mains ? Encore faudrait-il que la nature naturelle, prétendument paradisiaque et perdue, existe : malgré sa connotation péjorative, « l’expression “fabrication des animaux” n’a pas de véritable signification scientifique. [...] Les hybrides d’espèces voisines existent dans la nature. La transgenèse correspond effectivement à quelque chose de nouveau : mais y a-t-il réellement “fabrication” d’une nouvelle créature dès lors qu’on ajoute à une espèce donnée un seul gène qui ne fait pas partie de son patrimoine génétique ? »[a] L’homme se fait l’égal du créateur en sélectionnant et en créant des espèces. L’homme hissé au rang de Dieu, l’homme possesseur des animaux de la création qu’il enferme dans des zoosh pour mesurer l’étendue de son pouvoir sur le monde à portée d’yeux.
*
« Je ne mange pas de miel, parce que ça fait travailler les abeilles. »[2] Cette phrase vous tirera de votre petit-déjeuner dogmatique. Elle vous fera rire : réfléchir sur le propre de l’homme. Vous mangez du miel, crime de lèse-sa-majesté des abeilles, et voilà près de sept mille ans que ça dure : des peintures rupestres en témoignenti. Manger du pain sans miel, et puis quoi encore ? Sans beurre. Sans lait. Sans saucisson. Et si les artichauts avaient un cœur ? Et si on guillotinait le blé en herbe ? Descartes : « mon opinion est moins cruelle envers les bêtes qu’elle n’est pieuse envers les hommes qui sont asservis à la superstition des Pythagoriciens [qui étaient végétaliens] et qui sont délivrés du soupçon du crime toutes les fois qu’ils mangent ou tuent des animaux »[3]. Merci, monsieur Descartes : on aimerait tant qu’ils engraissent. On aimerait tant qu’ils se sentent innocents.
À la télévision, au vingt-heures, un sujet sur des ligues de défense des animaux qui s’horripilent de l’élevage de chiens à des fins alimentaires, en Corée. Des images (volées, bien entendu) montrent comment un gentil congénère de votre basset se fait assommer pour finir dans l’assiette d’un sauvage. Quant à la commission indienne venue protéger les millions de vaches sacrées qui meurent dans nos abattoirs, on compte sur vous pour la recevoir en grande pompe. Au menu, du chat : ça a le goût du lapin en meilleur. Ce n’est pas votre chat Grisou qu’on mange, non : on mange un chat d’élevage, comme du poulet d’élevage. Comment ce simple mot, chat, peut-il vous couper l’appétit ? Les anthropologues expliquent aisément ce phénomène : les animaux familiers prennent place au sein d’un système de parenté métaphorique. Ainsi, d’un point de vue symbolique, manger des animaux familiers s’apparente à du cannibalisme. La consommation de chair animale renvoie à « la définition des limites du soi, de l’établissement d’une frontière entre le dedans et le dehors »[d]. Nos sécrétions, dès qu’elles ont quitté notre propre corps ou celui de l’amoureu(x,se) assimilé à son propre corps, sont répulsives : on lèche son sang à même sa blessure, on avale sa salive, etc., mais que l’on crache dans un verre, et sa propre salive devient répugnante. L’acte alimentaire déclenche des réactions de répulsion analogues à celles mis en jeu dans le cadre de la construction de l’identité : la répulsion s’instaure lorsque je crois me manger moi-même hors de mon propre corps. La chair comestible doit être chair désirable ou non-chair. Ainsi la consommation de viande « n’est possible qu’en imposant une discontinuité »[d], discontinuité que les sociétés industrielles établissent en faisant de la viande un produit industriel désanimalisé, morceaux découpés et nettoyés sous cellophane. L’immense et contradictoire variété des goûts et dégoûts culinaires des cultures humaines peut se résumer à l’assertion « tout ce qui est biologiquement mangeable n’est pas culturellement comestible »[d]. Toute culture a des interdits alimentaires : toute culture est donc partiellement végétarienne. « Entre toutes les bestioles ailées qui vont sur quatre pattes / ne mangez que celles qui ont des jambes plus hautes que les pieds pour sauter sur terre / Vous pourrez manger / la sauterelle selon son espèce / le criquet selon son espèce / le grillon selon son espèce / la locuste selon son espèce / Toute bestiole ailée qui a quatre pieds / horreur / Elle vous rendrait impurs »[4].
« Surprotection et survalorisation, touchant à la zoolâtrie, des animaux de compagnie ; hyperexploitation concentrationnaire des animaux de rente »[b] : des animaux de compagnie chéris comme des enfants ; d’autres dont les conditions de vie épouvantables ne gênent que dans la mesure où la qualité de la viande qu’ils fournissent risque d’en être amoindrie (avec, entre les deux, un statut intermédiaire pour le chevalb). C’est comme si l’affection dispensée à certains animaux servait en quelque sort d’excuse inconsciente pour l’oubli de tous les autres. Ce phénomène n’est pas propre aux sociétés industrielles : ainsi, chez les Indiens d’Amazonie, apprivoiser des animaux « représente une contrepartie, une réparation des méfaits dont les hommes se rendent coupables envers le gibier en le chassant. Cette contrepartie n’a évidemment de valeur que si les animaux ainsi maternés ne sont jamais ni tués ni mangés »[b]. La différence entre cette attitude et celle de notre société industrielle se situe dans le fait que la culpabilité des Indiens est consciente et assumée, ce que rappelle Georges Bataille : « Les chasseurs “primitifs” ne méprisent pas ceux qu’ils tuent. Ils leur prêtent une âme semblable à la leur, une intelligence et des sentiments qui ne diffèrent pas de ceux des hommes. Ils s’excusent auprès d’eux de les tuer, et quelquefois les pleurent, en un touchant mélange de sincérité distraite et de naïve comédie. » [5] Comédie peut-être, mais qui dit comédie dit théâtre, catharsis, culpabilité, et reconnaissance de la faute commise. En ce sens, le non-être des abattoirs modernes, l’absence de sang sur les mains de celui qui n’a pas chassé la viande qu’il mange, est tout simplement un déni de sa culpabilité vis-à-vis du monde animal : c’est comme si le chien qu’il caresse n’était pas du même monde que le mouton qu’il mange. « Nous pouvons nous-mêmes aimer les animaux, mais, en principe, nous les aimons dans la mesure où nous ne désirons ni les tuer, ni les manger. » Le regard de l’homme moderne à l’égard des animaux « est un regard absent » : « l’animal n’existe pas, et c’est pourquoi il ne meurt pas. Ou, si l’on veut, nous nous entendons pour escamoter sa mort, pour la dérober à nos yeux, pour faire un monde où l’agonie et la mort de l’animal soient comme si elles n’étaient pas. »[5]
*
De sorte que la vraie opposition entre végétaliens et non-végétaliens n’est pas celle de la frontière homme-animal. Elle est celle de l’acceptation de la souffrance et de son partage. « Le partage de la viande est un acte fondamental, sinon fondateur, de la vie sociale. Partager la viande, c’est aussi partager la responsabilité de la mise à mort et, en somme, la recycler symboliquement, la transformer en lien social. »[d] — d’où, dans l’Antiquité, le lien entre le refus de l’ordre de l’État et le végétarisme de certains philosophes grecs[6]. Proches des mouvements de libération animale issus de la philosophie de Peter Singer, les végétaliens se disent « antispécistes », i.e. contre la hiérarchie des espèces. En effet, ils se réclament d’une pensée utilitariste selon laquelle le but ultime de l’activité morale est la maximisation de la somme de bonheur dans le monde : or les animaux, quelle que soit leur espèce, sont susceptibles d’éprouver plaisir et souffrance ; on ne saurait donc établir de distinction homme-animal, ni de distinction entre un chien et un rat. Si l’on se bat pour sauver les tigres, pourquoi ne se bat-on pas pour sauver les poulets ? Est-il moral de ne sauver que ce que l’on a du plaisir à voir ? Les antispécistes dérangent, au même titre que les militants d’Act’up disant en pleine collecte de fonds pour le Sidaction qu’il ne faut pas seulement se battre pour la jolie petite fille malade, mais aussi pour le drogué qui emmerde la société. L’antispécisme des militants de la libération animale a le courage de poser la question de l’égalité des souffrances : et c’est en cela qu’il ne saurait être raillé. Contre l’écologie bien-pensante qui ne défend que deux catégories d’animaux, les animaux de compagnie et les beaux animaux sauvages, il ose proclamer que « la souffrance de chacune des centaines de millions de sardines en boîte a autant d’importance que la souffrance de la dernière des baleines bleues »[7]. Il répète inlassablement la question de la confrontation à la souffrance, telle que l’a si bien décrite Gombrowicz : « Aujourd’hui, j’ai fait le “chasseur de mouches” ; je les ai tuées tout simplement avec une tapette. [...] Naturellement, je ne les tue pas toutes du premier coup ; certaines tombent par terre, mutilées, et de temps en temps je découvre une mouche aux prises avec sa mort. Je l’achève alors immédiatement. Mais il arrive qu’elle trouve refuge dans une fente du plancher, et je n’ai plus accès à elle ni à sa souffrance. [...] Aujourd’hui j’ai peur — c’est bien le mot — j’ai peur de la souffrance d’une mouche. [...] La douleur devient pour moi le point de départ de l’existence, l’épreuve essentielle, par quoi tout commence et à quoi tout se ramène. »[8] Gombrowicz dit de cette « nouvelle sensibilité » (qu’il croit partager avec ses contemporains), qu’elle est « une menace terrible et gigantesque » : « pour nous, les gens de la nouvelle école, la douleur est la douleur, n’importe où qu’elle apparaisse, aussi terrifiante chez une mouche que chez un homme. Nous nous sommes peu à peu sensibilisés à la souffrance à l’état pur ; notre enfer est devenu universel »[8].
Le végétalisme vise à l’innocence absolue : il refuse toute forme de culpabilité. Or tout le monde est coupable, et les végétaliens aussi. L’absence de hiérarchie subjective est impossible. Les antispécistes ont d’ailleurs vite fait de tomber dans leur propre piège. Dans un « tableau récapitulatif et comparatif des animaux tués en France chaque année », ils quantifient la souffrance animale par le biais d’une surface hachurée : là où les chiens abandonnés, les chevaux consommés et la corrida ne représentent que des points infimes, les poulets abattus (près d’un milliard en 1997) représentent le quart de la page... — mais ils notent qu’il faudrait aussi parler « des poissons, lesquels ne sont jamais chiffrés qu’en tonnes (des dizaines de milliards de victimes, soit, comparativement au tableau ci-contre, plus de dix pages pleines. »[7] Les antispécistes sont ainsi eux aussi soumis à un choix : ils reprochent aux amis des loups de ne pas voir les poulets, mais eux qui voient les poulets ont du mal à voir les poissons.
Il y a toujours une frontière : pas une frontière homme-animal, mais une frontière entre ce qui est à moi et ce qui n’est pas à moi. Je peux y faire rentrer mon chien, un moineau que je crois reconnaître, et l’escargot que je décide d’aller reposer dans l’herbe — alors que si je l’avais écrasé, quelle importance ? C’est moi qui trace, tous les jours, la frontière de mon monde ; or qui dit frontière dit coupure et qui dit coupure dit souffrance. Je suis coupable de cette frontière. Certains restent dehors, victimes de la coupure entre la mort qui me touche et la mort que j’accepte, entre ce que je regarde et ce que je ne regarde pas, entre mon attention et mon indifférence. Allongé au soleil, Gombrowicz observe des scarabées « se traîn[er] laborieusement dans ce désert vers des buts inconnus »[8]. L’un d’eux gît sur le dos, renversé, promis à la mort. Tendant la main, il le retourne. « À peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique, dans la même position, agitant ses petites pattes. Je n’avais pas envie de bouger [...] mais pourquoi sauver l’un et pas l’autre ? » Pourquoi celui-là oui, tandis que celui-ci non ? « L’un serait heureux grâce à toi et l’autre devrait souffrir ? Je pris une brindille, tendis la main, et le sauvais. À peine était-ce fait que je vis un peu plus loin un scarabée identique dans la même position, agitant ses petites pattes. Le soleil lui grillait le ventre. Devais-je transformer ma sieste en tournée d’ambulance pour scarabées agonisants ? [...] Si seulement il avait existé entre lui et ceux que j’avais sauvé auparavant une frontière, quelque chose qui m’aurait autorisé à m’arrêter. Mais justement il n’y avait rien que ces dix centimètres de plus dans le sable, toujours ce même sable, mais “un peu plus loin”, un tout petit peu. [...] Je me levai et les sauvai, tous. » Si le texte s’arrêtait là, l’homme serait Dieu, sauvant tout le monde toujours et partout. Mais l’homme est encerclé dans sa finitude : « Et soudain le mécanisme s’enraya, facilement je coupai court à ma compassion, je m’arrêtai. “Eh bien, rentrons”, pensai-je, indifférent. »[8]
*
Reste à répondre à ceux qui sourient à l’idée même que l’on se pose tant de questions sur les animaux. Ceux-là se méfient des animaux, et plus encore des gens qui disent les aimer. Ils se méfient à raison de cette tendresse qui « frôle le raisonnement en quête de bouc émissaire »[c] : on aime le chatchien, on voit des gens qui font du mal au chatchien, on se dit que « le monde serait si beau, si pur et si paisible si de vilains persécuteurs n’y plantaient pas l’horreur »[c]. De fait, il n’y a que l’extrême-droite pour proposer un secrétariat à la condition animale[9], et il n’y a eu que le régime nazi pour promulguer une loi sur la protection animale au moment où il exterminait des millions d’hommes. On en arrive vite à suspecter de « dépravation perverse du sentiment » tout défenseur des bêtes, ce qui conduit à « l’absurde alternative »[10] : “ou les animaux ou les hommes”. Des gens qui n’aiment pas les hommes défendent les animaux, donc les défenseurs des animaux n’aiment pas les hommes, « comme si la coïncidence valait implication »[e].
« Vous parlez des animaux alors que des hommes meurent » : cette phrase, qui voudrait reléguer la philosophie du rapport de l’homme à l’animal dans la rubrique chiens écrasés, i.e. ce dont il est inutile et indécent de parler, est une aberration — aberration qui renvoie à la violence des sentiments provoqués par la confrontation de l’homme à l’animal. Pourquoi la simple juxtaposition de la souffrance animale et de la souffrance humaine est-elle si problématique ? Pourquoi lit-on dans l’Encyclopédie qu’« il faut détruire les ménageries[11] quand les peuples manquent de pain, car il est honteux de nourrir des bêtes à grands frais quand on a autour de soi des hommes qui meurent de faim » ? Pourquoi, face à une collecte de dons pour les animaux, y a-t-il toujours quelqu’un pour dire qu’il serait plus moral de donner cet argent à des gens qui ont faim ? Pourquoi cette phrase n’est-elle pas prononcée, lorsque tous les jours nous achetons des produits de consommation, alimentaires ou non, qualifiés, de manière totalement subjective, d’“utiles” ou d’“inutiles” ? Une image du XIXe siècle montre une riche demoiselle qui mange dans son salon ; la servante mange dans la cuisine : on appelle ça les classes sociales, etc., on connaît. Deuxième image : la riche demoiselle est attablée avec son chien, la servante mange encore dans la cuisine : c’est choquant. L’animal sert de point d’appui comparatif. Cette évidence (il y a des riches et des pauvres), c’est l’animal qui nous la renvoie de manière explicite, puisque les objets ne savent pas le faire. Les animaux ressemblent trop aux hommes, vivant et souffrant en silence ; et c’est bien cela qu’on leur reproche : de sorte qu’on ne sait pas s’il faut les inviter dans notre monde et leur apprendre à parler, ou les en faire sortir définitivement.
Cette seconde solution est celle de Georges Bataille[12], lorsqu’il affirme que l’animal « vit dans l’immanence, comme l’eau dans de l’eau, un morceau de milieu, une immédiateté qui ne peut pas se remettre à plus tard. » Ce à quoi Cyrulnik répond avec amusement : « Je crois que Bataille sous-estime King-Kong. Non seulement les grands singes savent fabriquer des outils, mais ils peuvent aussi les transporter sur le lieu éloigné où ils en feront l’usage adapté, vingt ou trente minutes plus tard. Ils connaissent comme nous le plaisir immanent, comme l’eau dans l’eau ou comme nous-mêmes sur la plage quand notre propre corps devient un morceau de la chaleur du sable, mais ils connaissent aussi le plaisir de la représentation quand ils jouent à se bagarrer ou quand leurs offrandes alimentaires et leurs mensonges comportementaux visent à manipuler les émotions de l’autre en faisant semblant d’être blessés ou en simulant la colère. »[c] Que l’on choisisse la parole, la bipédie, la fabrication d’outils, ou la notion de tabousf, la ligne de démarcation entre les hommes et les animaux reste problématique. Les tentatives pour clouer définitivement le bec des linguistes en faisant parler un singe ont plus ou moins échoué : faut-il s’en étonner ?g Cette attitude pèche par anthorpomorphisme : vouloir que les animaux nous ressemblent, au risque de méconnaître le propre de l’animale. Elle mène en ligne droite à la notion de hiérarchie objective entre les espèces — qui plonge les chercheurs dans l’expectative lorsqu’ils découvrent que la stupide poule sait se reconnaître dans un miroirf, prérogative humaine entre toutes. Dans son Essai sur la Physiognomonie, destiné à faire connaître l’Homme et à le faire aimer (1783), Lavater affirme : « Le singe n’est qu’un animal, malgré sa ressemblance avec l’Homme, bien loin d’être second dans notre espèce, il n’est pas même le premier de l’ordre des animaux puisqu’il n’est pas le plus intelligent ».
À la question du silence des bêtes, et de la supposée hiérarchie de l’intelligence entre les animaux, Montaigne a déjà répondu : « La présomption est notre maladie naturelle et originelle. La plus calamiteuse et frêle des créatures, c’est l’homme, et quant et quant [et en même temps] la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici, parmi la bourbe et le fient du monde [...] et se va plantant par imagination au-dessus du cercle de la Lune et ramenant le ciel sous ses pieds. » [13] C’est par cette même vanité que l’homme s’extrait de la foule « des autres créatures, taille les parts aux animaux ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de forces et de facultés que bon lui semble. Comment connaît-il, par l’effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux ? Par quelle comparaison d’eux à nous conclut-il la bêtise qu’il leur attribue ? [...] Ce défaut qui empêche la communication [entre les bêtes] et nous, pourquoi n’est-il pas aussi bien à nous qu’à elles ? »[13] Et Aristote[14] : « Dans toutes les œuvres de la nature réside quelque merveille. Il faut retenir le propos que tint, dit-on, Héraclite à des visiteurs étrangers qui au moment d’entrer s’arrêtèrent en le voyant se chauffer devant son fourneau : il les invita, en effet, à entrer sans crainte en leur disant que là aussi il y avait des dieux. On doit, de même, aborder sans dégoût l’examen de chaque animal avec la conviction que chacun réalise sa part de nature et de beauté. »
*
Gombrowicz rappelle qu’on a vite fait de revenir dans le monde des hommes : « Comprendre la nature, la contempler, la regarder, c’est une chose. Mais lorsque je tâche de l’approcher comme quelque chose d’égal à moi du fait de la communauté de la vie qui nous englobe, lorsque je tâche de “tutoyer” les animaux, les plantes, une somnolence hostile me saisit, je perds l’élan, je rentre au plus vite dans mon humaine maison et je ferme la porte à double tour »[8].
Laetitia Bianchi