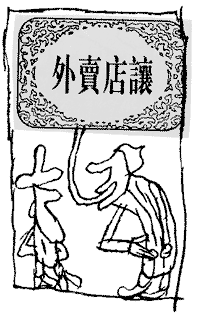



(Comique trip, 2001).
a. Lazare Sainéan, L’Argot ancien (1455-1850), Slatkine, 1972.
b. François Gaudin & Louis Guespin, Initiation à la
lexicologie française, Duculot, 2000.
c. Louis-Jean Calvet, L’Argot, QSJ ?, 1994.
d. Pierre Guiraud, L’Argot, QSJ ?, 1956.
e. Pierre Guiraud, Les Mots savants, QSJ ?, 1968.
f. André Blavier, Les Fous littéraires, Éditions
des Cendres, 2000.
g. Marcel Schwob, Études sur l’argot français, 1889,
éditions Allia, 1999.
h. Victor Hugo, Les Misérables, 1862.
1. I.e. "on a sifflé la pièce".
2. Pidgin est l’altération du mot business prononcé en chinois.
Les pidgins sont des langues nées du contact, à la fin du XIXe
siècle, entre l’anglais et les langues d’Extrême-Orient.
3. Entendre le jars signifie "comprendre le jargon", et donc "être
rusé".
4. Rabelais, Pantagruel, vi, 1532.
5. A. Becker-Ho, Les Princes du jargon, Gérard Lebovici, 1990.
6. Le loucherbem transforme les mots par le procédé suivant: remplacement de la première lettre par un l + mot + première
lettre + suffixe en -em ou en -oque : "boucher" donne ainsi "loucherbem",
"fou" donne "loufoque", etc.
7. Saussure, Cours de linguistique générale, 1912.
8. A. Rey, in Langue française, n°106, 1995.
9. Et des farfelus qui veulent percer l’origine de toute les langues, cf.
chapitre « Myth(étym)ologies », in ([f]).
10. A. Paraz, Le Gala des vaches, Éditions de l’Élan,
1958.
11. F. Domergue, Journal de la langue française, 1791.
12. Rabelais, Gargantua, xvi, 1534.
13. Respectivement : Richelet, Dictionnaire français, 1680,
et Le Roux, Dictonnaire comique, satirique, critique, burlesque, libre
et proverbial, 1718.
14. Le Jargon ou Langage de l’Argot réformé, 1628 (2e
éd., la seule connue).
15. A. Peyrefitte, Le Mal français, Plon, 1976.
16. Molière, Les Fourberies de Scapin, III, 2, 1671.
17. Proust, Sodome et Gomorrhe, 1921-22.
18. Cf. L. Cédelle in Le Monde de l’éducation, octobre
2000.
19. M. Quenet, « Messieurs les énarques, parlez français! », in Le Journal du dimanche, 22.VII.2001.
20. Desfontaines, Observation sur les écrits modernes, 1735.
21. Rimbaud, « Le cœur du pitre », dans la lettre à Paul
Demeny du 10 juin 1871.
22. Balzac, Le Père Goriot, 1834.
23. Étiemble, Le Jargon des sciences, Hermann, 1966.
24. Desargues, Brouillon du projet d’une atteinte aux événements
des rencontres d’un cône avec un plan, 1639.
25. Remy de Gourmont, Esthétique de la langue française, 1895.
26. Balzac, La Dernière Tentation de Vautrin, 1847.
27. Cf. « Les javanais », in Langages, mars 1991.
28. Mathieu de Chartres (A.M. Sieur des Moystardières), Devis de
la langue françoise, fort exquis et singulier, 1572.
29. Cf. Platon, Cratyle (dialogue sur le rapport des mots et des choses).
30. R. Jakobson, Six leçons sur le sens et le son, Minuit,
1976.
31. Aristote, La Poétique, 1459a.
32. Montaigne, Essais, I.xlvi, 1588.
33. Kafka, Journal, Notes de voyage, 8 septembre 1911.
34. Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932.
35. Kafka, Journal, 27 décembre 1911.
36. Nabokov, Ada ou l’ardeur, 1969.
37. R. Zazzo, Les jumeaux, le couple et la personne, P.U.F., 1960.
38. Henri Michaux, Lointain intérieur, 1963.
39. Fred Vargas & Baudouin, Les Quatre Fleuves, Viviane Hamy,
2000.
40. Vian, in Cahier 21 du Collège de ’Pataphysique, 22 décembre
1955.
41. Joyce, Ulysse, 1922.
Les académiciens ne parlent pas argot : mais ils jargonnent, assurément. On ne les comprend pas, et pourtant ils ne parlent pas une langue étrangère. Le jargon désigne toutes les formes dérivées de la langue commune utilisées au sein d’un groupe restreint. Le jargon ne modifie pas la grammaire, mais le lexique de la langue. Le jargon n’est donc pas une langue d’appoint comme le sabir, le petit nègre, le pidgin[2] ou le bèche-de-mer, langues approximatives dont le but est de pouvoir communiquer avec un étranger. À l’origine, le terme jargon désigne le langage des voleurs[a] : il est synonyme de notre argot. Il coexiste au XVe siècle avec le terme jobelin, issu des railleries dont le personnage biblique Job est l’objet : jobe signifie alors "niais" ; le jobelin est le langage des imbéciles ou des enfants. Apparaît là la dualité du jargon : ne comprend-on pas ceux qui jargonnent car ils sont idiots, ou car ils sont rusés et cachent leurs secrets ? Le jars qui crie garg, garg (onomatopée d’où serait issu le mot jargon) est-il bête comme une oie, ou "entend-il le jars"[3] ?
Celui qui jargonne sait qu’il jargonne : la fonction fondamentale du jargon est de signifier l’appartenance à un groupe, donc de se démarquer des autres, donc de n’être pas compris par les autres (fonction dite « cryptique », i.e. "qui cache", du jargon). Un universitaire explique avec le plus grand sérieux : « Il est des situations dans lesquelles les locuteurs n’ont aucun intérêt à ce que des oreilles étrangères les comprennent. C’est par exemple le cas des commerçants qui, discutant entre eux devant les clients, peuvent avoir à dire des choses qu’ils tiennent à garder secrètes ("donne-lui le pain dur qui reste d’hier") »c. Jargonner, c’est aussi créer sa langue au sein de la langue courante. Créer une langue ? On aurait donc le droit de créer des mots qui ne sont pas dans le dictionnaire ? Qui ? Comment ? Le jargonneux dispose du pouvoir suprême : donner un nom aux choses, faire naître des mots, les faire mourir. « Et merde merde dit Pantagruel, qu’est-ce que veut dire ce fou ? Je crois qu’il nous forge ici quelque langage diabolique, et qu’il nous ensorcelle comme un sorcier. »[4] Le jargonnard use d’un tel pouvoir à ses risques et périls — pour qui se prend-il, à ne pas parler comme tout le monde ?
Les mythes de la pureté de la langue
et de l’origine des mots
Autre mythe lié à la notion de jargon, celui de l’origine des mots : jargonner, c’est créer des mots qui n’existent pas, des néologismes — mais d’où viennent-ils, ces mots, ces sons nouveaux ? Il est des dictionnaires d’étymologie qui le disent, et qui se contredisent[9]. Le mot argot provient-il, comme le pense Furetière, du nom de la ville d’Argos en Grèce, car l’argot renferme un certain nombre de mots grecs ? ou de l’ancien français argoter, "se quereller" ? de ergot, "ongle", "griffe", par extension "vol" ? du nom du truand Ragot en verlan ? de ragot (grognement du jeune sanglier), "bavardage" ? de jargon, par altération phonétique ? de la racine latine -arg ayant donné argutie (finesse, ruse) ?[a] En matière d’étymologie, il fait toujours bon se moquer des autres : « Ce professeur (un nommé Albert Bayet, probablement normalien) tient une rubrique d’étymologie : "la vie et les mots". Il nous explique l’étymologie du mot blablabla en commençant ainsi : "Je ne sais au juste quand il est né". Alors, congre debout, si vous ne savez pas, fermez-la ! Le monde entier sait que blablabla est une invention de Céline. [...] Le pauvre Bayet s’imagine que blablabla est issu de blague. [...] Les soldats auraient l’habitude de conter des histoires au moment où ils tirent leur blague pour fumer, d’où l’habitude d’appeler ces histoires des blagues ! ... Pénible... »[10].
Pénibles, les fautes de langage ? On ne peut pourtant lutter contre la langue — où un mensonge qui a force d’usage devient vérité. Un grammairien se plaint du faux usage de l’adjectif romantique : « je croirais que romantique nous a été donné par une femme qui ne savait pas l’orthographe, si je ne savais pas qu’il nous vient du romantic des Anglais ; mais romantic signifie romanesque »[11]. Il a eu raison, aujourd’hui il a tort. Combien de mots proviennent ainsi d’étymologies dites « fausses» ? Bikini a donné monokini alors que bikini est le nom d’un atoll et non d’un improbable "double-kini", idem trimaran après catamaran et bureautique après informatique. Dans copains comme cochons, le cochon n’est qu’un soçon (du latin socius), "compagnon", et pourtant il a groin et truculence : puisqu’on le croit, et que cette expression n’est peut-être arrivée jusqu’à nous qu’en raison de sa jolie confusion. Toutes les étymologies sont fausses. Dans Les Misérables, Hugo écrit : « Si j’étais sur la place avec mon dogue, ma dague et ma digue, [...] locution de l’argot du peuple qui signifie mon chien, mon couteau et ma femme »[h]. Outre le fait que dogue et dague n’ont rien d’argotique, « l’ennui est qu’ici Victor Hugo invente le mot digue, ce qui est son droit, [or] il va être cru sur parole par de nombreux auteurs et dictionnaires d’argot »[c] — les dictionnaires se copiant les uns les autres, voilà comment « la littérature peut parfois abuser la lexicographie »[c]. Il ne reste plus qu’à espérer qu’un jour on retrouve un ouvrage inconnu de tous prouvant que le mot de Hugo était bien réel, ou qu’à croire que « Gargantua éprouva bien du plaisir, et sans autrement se vanter, dit à ses gens : "Je trouve beau ce", depuis lors ce pays fut appelé la Beauce »[12].
La fonction cryptique des jargons
Les élites sont également accusées de jargonner. Tout le monde parlerait mal de nos jours, alors que, dixit un académicien, « Montaigne, Calvin et Rabelais écrivaient en bon français. Tout homme cultivé les comprenait sans difficulté »[15]. Rabelais, dont la langue fourmille d’argot et de néologismes ! La comparaison est diablement mal choisie, d’autant plus que la Renaissance est l’une des périodes où l’on a sans doute le plus jargonné, étant donnée la concurrence du français et du latin. Il n’en demeure pas moins que chacun a toujours l’impression de vivre en l’époque où la langue est la plus malmenée, et la plainte de Molière contre les hommes savants et femmes savantes perdure : « Ah ! peste soit du baragouineux ! »[16]. Proust le dit plus joliment encore : « [Il] me parla de la grande chaleur qu’il faisait ces jours-ci mais, bien qu’il fût lettré et qu’il eût pu s’exprimer en bon français, il me dit : "Vous ne souffrez pas de cette hyperthermie ?" C’est que la médecine a fait quelques petits progrès dans ses connaissances depuis Molière, mais aucun dans son vocabulaire »[17]. La pédanterie, ce serait ainsi le jargon non nécessaire, par opposition au jargon scientifique, qui lui est admis — les scientifiques ont besoin de forger des mots, puisqu’ils forgent des idées. Conséquence d’un tel état de fait, ce sont les sciences humaines, bien plus que les sciences dures, qui voient leur jargon le plus contesté. Personne n’a jamais accusé un géographe de dire « subduction » (quoique... cf. infra), en revanche le sociologue fait souvent rire. Prenons la polémique du référentiel bondissant lancée par Claude Allègre. L’ancien ministre de l’Éducation s’en prenait au « volapük » de certains de ses pairs : « Le sommet, ce sont certains cours de pédagogie des IUFM. On parle, par exemple, du "référentiel bondissant" : c’est un ballon »[18]. Que la sociologie du sport ait son jargon, voilà qui pose problème : la discipline n’est pas considérée comme assez noble. De même, le jargon administratif suscite des critiques, car qui a intérêt à ce que la déclaration d’impôts soit difficile à comprendre ? Quelle caste s’en trouve protégée ? Aucune. Or « c’est comme une langue étrangère. Plein de mots bizarres comme "nom patronymique", "allocataire" ou "assujetti" »[19]. Le ministère de la Culture vient de mettre en place un Comité d’orientation pour la simplification du langage des administrations dont le mot d’ordre est : « que le langage utilisé par l’administration soit le plus proche possible du langage parlé ». Et de comparer l’action du gouvernement à l’œuvre de François Ier : « Avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts, le roi a décidé que la langue de l’administration ne serait plus le latin mais le français. Aujourd’hui, parfois, l’administration parle un langage qui, dans la tête des gens, est proche du latin » [19].
Ainsi en matière de langage, la tension entre le respect et le mépris pour ce que l’on ne comprend pas est permanente. Le langage est le lieu du jugement de l’autre : âne, cachottier, snob ou génie ? Devant un mot inconnu, chacun a fait l’expérience des réactions possibles : le mépris (« ce mot n’existe pas, il n’est pas dans le dictionnaire », « c’est une faute »), la suspicion (« tu fais exprès pour que je ne comprenne pas ? »), l’agacement (« c’est snob », « tu ne peux pas dire truc comme tout le monde ? »), le respect (« c’est un terme de spécialiste », « ça veut dire quoi ? »). Entre les quatre, la frontière est souvent incertaine — puisque précisément on ne comprend pas ce qui est dit. Où est la part de science, où est la part de complication inutile ? Derrida est-il Héraclite ? Aristophane se moquait bien de Socrate : l’histoire lui a donné tort.
Néologie et langage scientifique
À vrai dire, la langue oublie beaucoup plus de néologismes qu’elle n’en retient. Grands forgeurs de néologismes, les scientifiques, qui constatent souvent « l’échec de leurs terminologies »e. Personne ne connaît la paradrasie des grammairiens Damourette et Pichon, « répartition des termes qui servent à apprécier en autumatifs confrontatifs, effluxifs, exigentiels »e. Mais on apprend bien les propositions conjonctives, le substantif et l’épithète à l’école primaire, or le terme autumatif n’est pas plus difficile que le terme substantif. De même, de nos jours, qui peut taxer l’oxygène ou l’orthographe d’être du jargon ? Pourtant, en tant que tels, il sont tout aussi difficiles qu’orthopnée ou orthose, termes jargonnants — et lorsqu’en 1787 la nouvelle nomenclature de la chimie a été adoptée, écartant les noms anciens de l’alchimie, ne doutons pas qu’il y eut des esprits chagrins pour se plaindre de ce que le vitriol de lune laisse place au sulfate d’argent, l’air vital à l’oxygène, et l’air inflammable à l’hydrogène. Ainsi, il y a eu « banalisation lexicale »[b], c’est-à-dire diffusion de termes relevant d’un domaine technique dans la langue courante. Le phénomène se produit tous les jours : relayée par les médias, la traçabilité entre actuellement dans la langue courante via l’affaire de la vache folle.
De sorte que comme celles de Mac Orlan, les lamentations d’Étiemble n’ont pas lieu d’être : « Si encore ce charabia pouvait rester confiné chez les spécialistes ! [...] Oui, si les langages techniques se confinaient au secret du laboratoire, relativement peu nous importerait la laideur de tous ces mots-là. Chaque discipline jouerait avec son jargon, ainsi qu’avec son argot le potache, et la langue n’en pâtirait guère »[23]. On revient au mythe du cloisonnement des langages. Pourquoi, demande Étiemble, faut-il que le chardon aux ânes se transforme « en onoporde puis, honteuse apparemment de cet e final encore un peu francisant, un vrai mot grec, un gracieux onopordon »[23] ? Étiemble aurait sans doute apprécié le mathématicien Desargues[24] qui tentait, au XVIIe siècle, de parler français plutôt que grec ancien, transformant en colonne le cylindre, en cornet le cône et en brin de rameau le segmente... Que peut-on lui rétorquer d’autre, que l’évolution naturelle de la langue ? Étiemble a peur qu’un terme nouveau chasse un terme ancien, « de même que l’omoplate a chassé le joli paleron ». Mais croire que le mot omoplate est laid, c’est croire que les sonorités des mots sont objectives — or le sont-elles ? Pour qui n’a connu que l’omoplate, le paleron n’est au mieux qu’un gros poisson ou un outil, et l’omoplate porte très bien son nom.
Le son des mots
Largongi, loucherbem[6], javanais, verlan : autant de manières de jargonner par déformation linguistique (et non sémantique). Ces diverses déformations existent dans toutes les langues. Les javanais sont les langages codés qui ajoutent des syllabes, par exemple -av, à l’intérieur de chaque mot : une bavelle ravousse. Le verlan, inversion des syllabes qui existe dans toutes les langues et à toutes les époques, peut se doubler de contraintes d’ajustement rythmique : ainsi, dans l’argot des musiciens de jazz japonais[27], toujours retomber sur quatre syllabes — de sorte que kao ("visage") devient ookaa. La principale technique de déformation des mots reste cependant l’adjonction d’un suffixe, phénomène immuable, mais dont la forme varie au gré des époques, sans que l’on sache pourquoic. Le jargon scientifique a ses suffixes en -ité, -itude, etc., de même que l’argot a les siens : -caille (au XVIIe, icicaille), -aque, -oque, -uche, -oche, -go (labago, "là-bas"), -mar (au XIXe, cafémar), -rama, -ard, etc. Hugo encore : « l’argot se borne à ajouter indistinctement à tous les mots de la langue une sorte de queue ignoble, une terminaison en aille, en orgue, en iergue ou en uche. Ainsi : Vouziergue trouvaille bonorgue ce gigotmuche ?[h] . Mais voilà : la laideur « ignoble » dont parle Hugo ne tient pas. Car si on peut taxer la paluche et le nunuche d’être « difformes et empreints d’on ne sait quelle bestialité fantastique », que dire de l’élégance de la coqueluche et de la douceur de la peluche, deux anciens termes argotiques ? La gniaque enlaidit-elle l’insomniaque, et la pouascaille la trouvaille ? Les mots abasourdir, arlequin, amadouer sont d’anciens termes argotiques, aujourd’hui soutenus : sont-ils laids ?
On voudrait des mots « beaux et bien français » : l’argument ne tient pas. Mathieu de Chartres publie en 1572 un Devis de la langue françoise, fort exquis et singulier, où il s’en prend à « ce million de termes [...] dont le son estoit plus déplaisant à ses oreilles que n’eust été le son d’une cloche cassée »[28]. Et de demander l’emploi de mêmeté et non d’identité, de puissantiel et non de potentiel, et de mouvement tremblotif à la place d’oscillation. Or de nos jours, celui qui parle de mêmeté jargonne drôlement. Nombreux sont à ce titre les mots qui ne sont pas attestés, bien qu’ils soient conformes aux règles de formation du français : on dit arrêt et non arrêtage, et si au Niger on dit essencerie pour "station-service" et douchière pour "endroit où l’on prend sa douche", croit-on que les linguistes se réjouissent ? Non pas : ils parlent de « français populaire local »[c]. Ainsi, lorsque l’Académie recommande un terme en -ière, suffixe bien français, le terme est correct ; lorsque c’est le peuple qui l’invente, le terme a beau sonner comme il faut, il reste « populaire ». Quelle preuve plus éclatante du fait que le son n’est rien en tant que tel ; et que seul l’usage décide du niveau de langue auquel il appartient ?
On voudrait l’union du son et du sens, du signifiant et du signifié, selon l’idée de Cratyle[29]. Le corbeau d’Edgar Poe dit Nevermore, et cela sonne triste : « nous nous trouvons immédiatement devant le mystère de l’idée incorporée à la matière phonique »[30]. Nevermore est triste et schtroumpf, inventé par hasard par le dessinateur Peyo, est absurde. Première constatation, en allemand il est schlumpf, en italien puffo et en japonais sumafu. Deuxième constatation, schtroumpfant n’a pas le même sens que schtroumpfesque ni schtroumpfard, et la schtroumpfitude n’est pas la schtroumpferie — pourquoi ? C’est comme si le cerveau traitait en l’espace d’une seconde l’ensemble des adjectifs connus similaires : burlesque, grotesque, et effectuait un rapprochement. Le son implique le sens — parfois des sens concurrents, ainsi que le montre le jeu du dictionnaire (plusieurs personnes imaginent chacune une définition à un mot inconnu). Voilà en tout cas de quoi récuser les projets de langues universelles, lesquelles ne peuvent même pas trouver un nom. Ainsi le volapük, langue artificielle créée en 1879, dont le nom signifie littéralement "langue du monde" (vol, sur la racine world, et puk, sur speak), a en français une sonorité ridicule qui contient sa réfutation la plus féroce : le volapük est aujourd’hui synonyme de charabia multilinguistique. La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie (1835) stipule : « Il faut que chaque mot d’une langue en quelque sorte soit frappé d’une empreinte particulière, qui marque son titre et sa valeur, comme chaque pièce de la monnaie d’un peuple ; il faut qu’en donnant ou en recevant un mot, on sache ce qu’on reçoit ou ce qu’on donne, comme en donnant un écu ou un louis ». C’est le cas. L’-ük, l’-uche, l’-esque, l’ -itude, l’-ard, détachés des mots, ont un sens.
Métaphores et jeux de mots
Poser ainsi, comme le fait Pierre Guiraud, l’opposition entre l’intelligence de l’abstraction et l’inculture du concret, c’est oublier que tout mot est une abstraction : « Quelque diversité d’herbes qu’il y ait, tout s’enveloppe sous le nom de salade »[32]. Personne n’a jamais vu la salade ni la bêtise : or le bon peuple sait dire salade et bêtise, il est donc capable de dire altruisme, sociologiquement et traçabilité. Là où il n’y a qu’une différence de lexique, certains veulent voir une différence de procédés linguistiques. Sans doute faudrait-il leur rappeler que le jargon des poètes use des mêmes procédés. Reprenons les exemples d’expressions soutenues cités par Hugo : l’amour se dit les feux, la beauté les appas, le chapeau à trois cornes le triangle de Mars, etc. Or, si on ne savait pas qu’elles sont soutenues, ces expressions imagées pourraient tout aussi bien être argotiques : les appas (ou appât), littér. nous dit le dictionnaire, ce qui appâte, "ce avec quoi on fait engraisser les oiseaux", sont-ils moins concrets qu’une fille qui est bonne ? Les feux de l’amour, littér., sont-ils moins brûlants et physiques qu’être tout feu tout flamme, loc.fam., ou qu’avoir le feu, loc. vulg. ? En quoi le triangle de Mars diffère-t-il, linguistiquement, de la plume de Beauce ? Tous les jargons se forment ainsi à partir du procédé-roi du langage, la métaphore. Kafka voit Paris « rayé »[33] et Céline voit New York « bien raide, là, pas baisante du tout »[34], on crie au génie : acceptons donc le génie des métaphores anonymes — et le ratage de certaines : « Comme l’image précédente a peu de vigueur ! Une condition préliminaire est placée comme une planche entre le sentiment réel et la métaphore de la description » [35]. La métaphore ratée, planche instable, quelle meilleure métaphore ?
La métaphore est inutile aussi parfois : les lexiques des langues sont autant de métaphores éteintes. Dans l’expression retourner sa veste, les linguistes disent qu’il y a « démotivation » par rapport à veste : le mot "veste" n’existe qu’à l’intérieur de cette expression toute faite dont on connaît le sens global. Or ces locutions peuvent être brutalement « défigées », i.e. « menacées d’un double fonctionnement »[b] (fonctionner à la fois au sens propre et au sens figuré), et c’est ainsi que naissent connotations, métaphores et jeux de mots : Il a retourné sa veste, il retournera son pantalon. Lorsque je dis il pleut des cordes, est-ce que j’imagine des cordes ? À la fois oui et non : comme un tableau d’Arcimboldo, où parfois l’on ne perçoit plus que le visage de l’homme et non les éléments distincts qui le composent, et où parfois on observe un élément au risque de perdre la vision globale. Dans l’usage quotidien de la langue, tout un chacun connaît cette sensation : le va-et-vient de l’œil et de la pensée entre le détail et l’ensemble et le détail, entre la lettre et le mot, entre les cordes et il pleut des cordes. Cet entre-deux, ce mouvement sans fin entre les mots et ce qu’ils enferment, plus il est long et riche, et plus chargés de sens sont les mots. La langue courante serait ainsi comme des tableaux dont on ne cherche pas à percevoir les détails, pressés et habitués que l’on est à les regarder de loin, cependant que le but du jeu de mots serait d’y percevoir un détail nouveau. Triple jeu de mots, quand l’almanach Vermot se fait littérature avec Nabokov : « il aimait les vieux maîtres, les jeunes maîtresses, et les jeux de mots d’âge intermédiaire »[36].
Langages personnels
L’analyse clinique du jargon, invention d’un langage donc déconstruction des normes du langage courant, a vite fait de confondre littérature et folie. « L’écriture de Mallarmé se caractérise par l’atélophémie, l’idiophémie, la leipophémie, la paraphémie, la stéré ophémie, et l’apatélophrasie, tandis que celle de Joyce manifeste des tendances à la polyphémie, la spasmophémie, la tachyphémie, la dramatophrasie, l’embolophrasie, la cataphrasie, l’échophrasie, la planophrasie et la schizophrasie. On voit qu’en fait de néologisme et de "jargonographie", les psychiatres ne sont pas en reste sur leurs patients. »[f] Dans Les Fous littéraires[f], André Blavier cite des extraits de l’œuvre d’un certain Jacques Lambrecht, tenu pour fou et interné à ce titre. Sa Jugulaire, Wellingtonienne en vingt-deux épigées, a été écrite en 1902 ; l’auteur y raconte ses malheurs à coup de néologismes : « Vers fin douze-cent et dix donc, constatai que ne savais plus m’accorager et comment me dépétrer ? Un jour, que prenais langue avec abbé Quentin Wulver, celui-ci flirta : "Chic, si Carotide en voulaient de votre cornette." Carotide hennit bruyamment, cabra argots »[f]. Ce fou devançait ainsi de plusieurs décennies les recherches langagières d’un Henri Michaux : « Jarrettes et Jarnetons s’avançaient sur la route débonnaire. Darvises et Potmons folâtraient dans les champs. Une de parmegarde, une de tarmouise, une vieille paricaridelle ramiellée et foruse se hâtait vers la ville »[38].
Ainsi, socialement, seul l’écrivain a le droit de se couper du monde : on ne peut être le seul à savoir que l’on crée une langue. Grégoire Braban, personnage d’un roman policier de Fred Vargas et Baudoin, parle mal ; il dit un caillouxe, un hibouxe, et même un trouxe. Explication : « Moi ça me calme. Je ne dis pas que ça donne un sens à la vie. Mais disons ça fait un but, une innovation. J’ai pas l’impression de servir à rien. Je transforme un petit bout du monde, au moins. On ne peut pas savoir... Peut-être qu’un jour tout le monde dira "trouxe", en croyant que c’est de toute éternité »[39]. Jargonner : transformer un petit bout du monde, s’il est vrai que tout le monde peut inventer des mots. L’enfant qui dit moucola pour "mousse au chocolat" n’est pas plus paresseux que l’académicien qui écoute chaque matin Alain Rey sur son transi[fer resi]stor. Mais inventer une langue ne va pas sans risque : le ridicule. Dans son Petit fictionnaire illustré (1981), Alain Finkielkraut propose altipute, "prostituée des stations de sport d’hiver", boulangélique, "qui a le visage poupard et bouffi d’un chérubin gourmand", délicaresse, "étreinte très douce", etc. Peut-être, dans une tirade de San Antonio, l’altipute serait drôle, de même que dans un monologue de Joyce la délicaresse serait belle. Mais alignés en rang d’oignons dans le livre d’un non-écrivain, ce ne sont que des mots à vendre, aussi bêtes que les michokos et les taillefines, fruits des longues recherches de créas essayant vainement d’être aussi créatifs que ceux qui font changer la langue. On ne contrefait pas le travail de l’écrivain ou la trouvaille anonyme : les mots-valises de Lewis Carroll, Laforgue, Joyce, etc., qui accélèrent la langue courante lorsqu’elle ne va pas assez vite, la saveur d’une nuit grave (cigarette, à cause de la mention obligatoire "nuit gravement à la santé" sur les paquets) ou d’une conjoncture (bouteille de bière nigériane de format réduit, qui doit sa taille et son nom à un discours du président sur la "mauvaise conjoncture").
Boris Vian a exposé à ses collègues ’pataphysiciens comment travailler à démultiplier la langue, à partir d’une seule expression : « À bon chat bon rat peut paraître d’une nouveauté restreinte mais se prête, vous l’allez voir, à de mirifiques transformations. Je revins d’abord à la jarryque conception du rastron et rétablis le chapistron. À bon rapistron, bon chapistron, me dis-je (et par suite, À mauvais chapidem, bon rapidem, mais nous nous bornerons ici à des bouleversements substantifs). Puis, la lumière se fit (dans les quinze watts, car je ne suis pas riche), et je me dis que l’"at" pouvait sans inconvénient être retranché des deux termes de cette sorte d’égalité. [...] Ainsi, mathématiquement, l’égalité "À bon ch, bon r" est parfaitement correcte ; et mes quinze watts en firent bientôt vingt-cinq, lorsque je me mis en devoir d’ajouter des quantités égales et positives »[40]. Vian propose ainsi : à bon chien bon rien, à bon château bon rateau, à bon chieur bon rieur, etc. C’est sur un principe proche que les enfants jouent à 1 tronc, 2 troncs, 3 troncs, 4 troncs, 5 troncs, citron. Tout ça pour montrer quoi ? Qu’un jeu de mot, pris isolément, n’est bon qu’à entrer dans l’Almanach Vermot. Or lorsque Joyce transforme le "percolateur" en Père Colateur donc en « Révérend Père Caud »[41], que fait-il d’autre qu’une blague, caramba, carambar ? Inclus au sein d’une œuvre, redoublé d’un autre jeu de mots, il devient réflexion sur le monde : « Tu t’dis : Voilà un coin de jungle où ça piaule à qui mot mot. Tu dois pousser les hauts cris : Nom d’un petit bosquet, je donnerais bien une souche de hêtre pour avoir la moinillette idée de ce qu’il forêt comprendre à tout ça. Hue donc ma belle ! Les quat profs d’orthovangile ont peut-être le goudrum »[41]. Alors si votre oncle fait de mauvais calembours et que votre enfant pagarlege cogomege çaga, pas d’inquiétude : c’est le langage qu’on interroge — « Vraiment ? Omftdirvoir. Blmslva »[41].