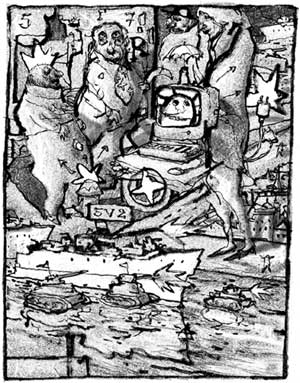
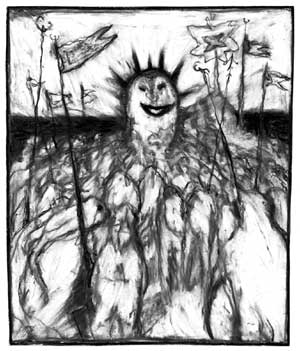
illustrations Nicolas de Crécy
a. Michael Herr, Putain de mort, 1e éd. 1968,
trad. française Albin Michel, 1980, rééd. l’Olivier,
1996.
[Michael Herr était correspondant au Vietnam pour Esquire.
Ouvrage dense écrit dans un style oral. Une histoire des soldats
plus que des journalistes, sauf les dernières pages, notamment sur
Larry Burrows et Tim Page.]
b. Jean Hatzfeld, L’air de la guerre, l’Olivier, 1994.
[Jean Hatzfeld était journaliste à Libération.
Il a été blessé en Yougoslavie en 1992.]
c. Horst Faas et Tim Page (dir.), Requiem par les photographes
morts au Vietnam et en Indochine, trad. française Marval, 1998.
[Ouvrage collectif regroupant un grand nombre de photographies de journalistes
morts au Vietnam ainsi que divers témoignages.]
d. Marcel Ophüls, Veillée d’armes. Histoire du
journalisme en temps de guerre, 1994, sorti en salles, et diffusé
sur Canal +.
[Par l’auteur du Chagrin et la pitié, un « vrai » film sur la question : Marcel Ophüls se met en scène
sur les traces des reporters en Yougoslavie (« Premier voyage »),
puis s’interroge sur le traitement de la guerre par les médias (« Deuxième voyage »).]
e. Patrick Chauvel & Antoine Nouvat, Rapporteurs de guerre,
diffusé sur Canal + le 6 mai 1999.
[Patrick Chauvel est photographe
de guerre. Le document qu’il a co-réalisé donne la parole
à beaucoup de ses collègues. Traitement un peu rapide, et
un peu « télé ». Cf. l’interview de P.Chauvel,
Le Monde, 3.V.1999.]
f. Daniel Lainé, reportage pour « Zone Interdite », diffusé sur M6 le 4 juillet 1999.
[Lainé suit notamment
Nicolas Poincaré en Roumanie, et Patrick Robert en Sierra-Leone
et au Kosovo.]
g. Phillip Knightley, Le correspondant de guerre, trad.
Flammarion, 1976.
[Une histoire des correspondants de guerre qui s’intéresse
surtout aux problèmes de la censure et à la difficulté
d’informer.]
1. Michael Rediske in Die Tageszeitung, repris et traduit par
Courrier international, 1.VII.1999. Retour au texte
2. Pour être absolument rigoureux, il faudrait distinguer les
assassinats en connaissance de cause (i.e. meurtre d’un journaliste
parce qu’il est journaliste), des morts « accidentelles »,
où le journaliste n’était pas spécialement visé.
C’est ce second cas qui nous occupe dans ces lignes. Retour au texte
3. « Assassinat de deux grands de la presse », Patrick
Saint-Paul, Le Figaro, 26.V.2000. Retour au texte
4. Interview par Frédérique Chapuis dans Télérama,
1.III.2000. Retour au texte
§
Les journalistes de guerre sont si proches des soldats qu’ils leur ressemblent.
Parfois jusqu’à être, comme Pierre Schoendoerffer en Indochine,
membres de l’armée. Schoendoerffer était caporal : « Tout comme un soldat qui a une quantité de limitée de munitions
ne fera feu que si son tir promet d’être efficace, il en était
de même pour moi avec ma caméra. [...] Quand j’avais
une longueur de film suffisante, j’arrivais à contrôler ma
peur. Quand je manquais de pellicule, quand je ne pouvais pas travailler
avec ma caméra, je ressentais la peur. »[c] Au
moment de la chute de Diên Biên Phu, il s’identifie totalement
à ses camarades, jusqu’à s’englober dans un « nous » commun : « Jusqu’au tout dernier moment, il y eut un solide
espoir d’envisager encore une percée dans les lignes ennemies. Nous
étions jeunes et confiants. La poussée d’adrénaline
que nous procurait l’intensité des combats nous permit de garder
espoir jusqu’à cet instant fatal du 7 mai 1954 à 3 heures
du matin où l’ordre fut donné de détruire armes et
munitions. [...] Pendant que les soldats détruisaient leurs
fusils, je détruisis ma caméra. Pendant qu’ils détruisaient
leurs munitions, je détruisis mes films. »(c) Nguyen
Khuyên, correspondant pour la Vietnam News Agency, poursuit le rapprochement
: « Mis à part l’appareil photo, nos photographes de guerre
ne se distinguaient en rien des soldats »[c].
Détachés de l’armée depuis la guerre du Vietnam,
les journalistes continuent de la singer : « on est un peu comme
des militaires », explique le caméraman Patrice du Tertre[d]
à propos des reporters photographes ou caméramen, qui, « moins diplômés » que leurs confrères de la
presse écrite, auraient un rapport plus direct avec les combats.
Ce que détaille David Halberstam dans son introduction à
Requiem
par les photographes morts au Vietnam et en Indochine[c] : « [Les photographes de guerre] étaient vrais parce qu’ils se
devaient d’être vrais ; ils ne pouvaient, comme nous qui écrivions
nos articles, arriver un peu trop tard sur le lieu de l’action, être
mis brièvement au courant de la situation et ensuite, par l’utilisation
adroite d’interviews et de l’écriture, recréer une scène
d’une étonnante précision en faisant un superbe reportage
pris sur le vif et si proche alors qu’en réalité nous n’avions
jamais été sur place. Nous pouvions ne pas assister aux combats
et malgré cela faire notre travail. Pas eux. Il n’y avait qu’une
façon pour eux d’atteindre cette proximité : en étant
des témoins oculaires. »
À force de monter au front, certains journalistes s’approchent
dangereusement de la limite les séparant des soldats : « Il n’y avait pas de choix facile au Vietnam. Tous les reporters et tous
les photographes de terrain craignaient d’avoir à prendre une décision
de ce genre : que fais-tu quand tu te trouves confronté à
la perspective plus que probable de mourir ? Tu pries pour qu’un miracle
se produise ? Tu répliques à l’agresseur par les armes ?
Tu essaies de te rendre ? Tu acceptes passivement la mort ? Officiellement
les journalistes civils n’étaient pas des combattants et en principe
ne portaient pas d’arme. Officieusement certains étaient armés,
en général d’un pistolet. La majorité ne l’étaient
pas. C’était une question pratique aussi bien que morale : on ne
pouvait pas tirer et faire un reportage en même temps. Mais dans
les affrontements les plus rudes, les journalistes s’emparaient quelquefois
d’une arme et combattaient au côté des soldats qui étaient
le sujet de leur reportage. Pour certains l’excitation du combat rapproché
s’avéra l’expérience la plus intense de leur vie : rien n’était
aussi exaltant, rien ne donnait autant de valeur à la vie que le
fait d’y survivre » (John Laurence[c], journaliste pour
CBS au Vietnam entre 1965 et 1970).
À l’autre extrémité du spectre se trouve le journaliste
craintif, le mickey, selon le concept forgé par Paul Marchand, journaliste
radio indépendant grièvement blessé à Sarajevo,
filmé par Marcel Ophüls[d] et raconté par Jean
Hatzfled[b] : « Il porte un gilet pare-balles par tous les temps,
les rois des mickeys le gardant jusque dans la salle de restaurant, parfois
même jusqu’à chez eux, avec, souvent, un casque attaché
à la ceinture à côté du couteau suisse. »b
Paul Marchand s’oppose à cette conception d’un journalisme protégé
: « Pour ressentir la peur des gens, il faut être aussi vulnérable
qu’eux. »[d] Michael Rediske, le porte-parole en Allemagne
de Reporters sans frontières, dont c’est le rôle de protéger
les journalistes, défend une conception inverse : « Presque
tous les professionnels acceptent aujourd’hui de suivre la nouvelle règle
: ne jamais se déplacer sans être accompagné d’un guide
interprète. Du côté des rédacteurs en chef,
il est de leur responsabilité de ne jamais envoyer un jeune étalon
fougueux sur un terrain miné. [...] Les gilets pare-balles
et les véhicules blindés peuvent s’avérer efficaces
contre des tirs à distance, mais nul reporter n’est à l’abri
d’une mise à mort préméditée. »[1]
La question de la mort des journalistes sur le terrain est périlleuse
: car, on l’a dit, rien ne les oblige, à la différence des
soldats ou des civils locaux, à être présents sur les
lieux du conflit. Si un John Simpson de la BBC se félicite de la
discrétion de sa chaîne après la blessure dont a été
victime un de ses collègues en Yougoslavie (« c’est une
des fois où j’ai été le plus fier de ma boîte »[d]), les blessures ou la mort[2] de journalistes prennent
souvent des proportions énormes, car elles sont relayées
par les autres journalistes qui les connaissaient et par les médias
auxquels ils appartenaient : chevaliers blancs de l’information, les reporters
de guerre apparaissent comme des victimes particulièrement innocentes
(« La mort n’est pas leur métier », titre de
l’article de Michael Rediske). Mais toutes les victimes civiles ne sont-elles
pas innocentes ? Certains discours de journalistes occidentaux sont ambigus,
tant leur vie semble plus valorisée que d’autres : « Depuis
le Rwanda, j’ai changé. J’ai connu la folie, le mal absolu, et je
n’ai plus envie de m’y frotter, parce que ça m’a quand même
affecté » (Luc Delahaye, photographe à l’agence
Magnum[e]). « Ça m’a quand même affecté » : se pencher sur les journalistes de guerre, c’est mettre en valeur
les troubles d’occidentaux qui n’ont pas connu la guerre dans leurs pays,
qui vont voir les guerres ailleurs, et qui en reviennent « affectés ». Pourtant, hôtel, nourriture, moyens de transport, tout les
oppose aux gens dont ils rendent compte du quotidien. « Les correspondants
de guerre sont des privilégiés. Il ne faut pas les glorifier », affirme Martha Gellhorn, qui était journaliste durant
la Seconde Guerre mondiale. Cette différence dans le niveau de vie
est justifiée par le fait que les journalistes ont, dans un conflit,
un rôle particulier qui leur confère un statut spécial.
La vulgate défendue dans les discours officiels ressemble à
ces quelques lignes tirées d’un article sur la mort de deux reporters
de guerre : « Kurt et Miguel appartenaient à une race de
reporters à part. Conscients du danger, mais animés par une
volonté irrépressible de raconter les atrocités de
la guerre, ils étaient souvent en première ligne. »[3]
Une éthique professionnelle plus qu’un désir personnel
de se frotter aux conflits, c’est ce que tente d’imposer la vision officielle.
Mais le « je » prend trop d’importance, même dans ces
discours convenus : « Je veux uniquement me placer dans les situations
extrêmes pour compenser l’information trop édulcorée
qui nous est servie » (Philip Blenkisop, photographe spécialisé
dans les drames de l’Asie du Sud-Est[4]). « Très souvent
je me demande si j’ai le droit de tirer profit - car tel est souvent mon
sentiment - du malheur des autres. Mais ensuite je me justifie, à
ma manière toute personnelle, en me disant que je peux contribuer
modestement à faire comprendre ce que d’autres endurent ;
alors j’y trouve une raison de faire ce que je fais. »[c]
Sa « manière toute personnelle » semble n’avoir que
difficilement convaincu l’auteur de ces lignes, Larry Burrows, photographe
pour Life mort au Vietnam en 1965 : « Burrows avait couru prendre
des photos d’un Chinook qui allait atterrir. Le vent était assez
fort pour envoyer voler à 15 mètres sur la piste des plaques
de tarmac et il a traversé tout ça pour son travail, pour
photographier l’équipage, les soldats qui descendaient la côte
pour embarquer dans l’hélico [...] pour prendre les trois
blessés qu’on hissait à bord avec précaution, se retourner
pour les six cadavres enfermés dans leurs sacs. [...] Quand
ce fut fini, il m’a regardé avec un air de détresse profonde.
“Quelquefois, on a vraiment l’impression d’être un salaud” »[a].
Pour qui travaillent les reporters de guerre ? Les photographes interrogés
dans le film Rapporteurs de guerre sont quasi-unanimes pour dire
que leurs reportages intéressent beaucoup moins que n’importe quelle
photo du Prince Charles. Et l’on imagine qu’ils ne partagent pas l’intérêt
faussement curieux mais réellement commercial du patron de Sipa
Presse, Goskin Sipahioghu : « Je pense que les meilleures photos
qui arrivent maintenant, ce sont celles sur l’Algérie. À
mon avis, la grande histoire, maintenant, c’est l’Algérie, parce
que personne ne sait, et personne ne peut savoir à vrai dire pourquoi
ces gens sont tués, qui tue qui et pourquoi. Aucun journaliste n’a
pu déchiffrer ça »[e]. Chris Morris, de
l’agence Black Star, un des photographes de guerre les plus réputés
et les plus respectés, raconte, à propos de commentaires
négatifs sur ses photos d’un homme en train de se faire tuer : « J’ai décidé de ne plus prendre en compte l’opinion des gens.
[...] Je réalise que les gens ne savent même pas où
est la Bosnie, la Tchétchénie. Ils ne savent même pas
ce qui se passe. Ils sont plus préoccupés par leurs problèmes
quotidiens. Mais malgré cela je continuerai à faire mon travail.
[Question : Mais tu le fais pour qui, alors ? suivie d’un très
long blanc] C’est une bonne question. C’est une bonne question »[e].
Cette question, un autre photographe, Luc Delahaye, semble y répondre
lorsqu’il avance : « Je n’ai pas besoin de support. Je m’en fous
que ça soit publié. [...] Ce qui m’intéresse,
c’est d’avoir de l’argent pour aller faire le reportage »[e].
« Faire le reportage » — Martine Laroche-Joubert, grande reporter
à France 2, explique, à propos des poussées d’adrénaline
: « Je pense qu’il y a un côté drogue. [...]
Pour les reporters qui sont des gens très angoissés, les
conflits sont des thérapies parce qu’ils apaisent leurs conflits
intérieurs. »[d]
Aimer la guerre, c’est gênant : « Ça me paraît
indécent de dire qu’on s’amuse énormément dans tout
ce malheur. La vérité c’est que, si on est journaliste, aussi
déplacé que cela paraisse, il y a tout dans ce sujet, tout
ce dont on rêve. » (John Burns, New York Times[d]).
Ce dont ils rêvent, c’est le rock’n’roll. On ne peut pas définir
le rock’n’roll, on ne sait même pas qui a popularisé cette
expression au sein des reporters de guerre ; on la trouve aussi bien dans
le texte de Michael Herr (« Le temps et l’information, le rock’n’roll,
la vie elle-même, ce n’est pas l’information qui est gelée,
c’est vous. »[a]) que dans la bouche de Paul Marchand,
qui se réapproprie la notion, simple moyen de désigner les
moment où il se passe quelque chose : « on est ici pour
le fun, le rock’n’roll, pour l’argent... et c’est bien... et accessoirement
pour raconter ce qui se passe »[d]. « Accessoirement
raconter ce qui se passe » : rares sont les journalistes qui acceptent
de retourner l’ordre des priorités. Dans les discours, le plaisir
semble toujours être secondaire : « Dans les vingt dernières
années, ma foi j’ai été assez présent sur tout
ce qui s’est passé. Ça n’a pas toujours été
agréable, mais ça a été intéressant.
C’est comme ici [en Sierra-Leone], on ne peut pas dire que ce soit
agréable, on ne s’amuse pas vraiment, c’est glauque, on va à
l’hôpital, c’est morbide, on voit des gens qui souffrent, c’est insupportable.
Je suis toujours en train de me faire violence pour rester, pour me forcer
à faire des images » (Patrick Robert[f], photographe
de l’agence Sygma). Dans ces propos, le photographe glisse insensiblement
de l’aspect « intéressant » à l’aspect « morbide », comme s’il se rendait compte de l’indécence qu’il
y a, comme disait le journaliste du New York Times, à les mettre
sur le même plan. De même Nicolas Poincaré, grand reporter
à France Info, se défend d’aimer la guerre : « Il
y a des journalistes qui aiment ça physiquement, la peur, le danger.
Moi pas du tout. Il ne faut pas aimer ça, parce que c’est malsain.
C’est vrai, il ne faut pas cacher que dans des situations de guerre, il
y a des urgences, des moments très forts, qui peuvent être
agréables, il y a des amitiés qui se créent plus vite
qu’ailleurs ; mais il ne faut pas dire j’aime ça, je ne veux faire
que ça »[f]. « Il ne faut pas dire j’aime
ça » — comme s’il se forçait à ne pas aimer
« ça ».
Tous les propos évoquent la force des événements
vécus. Ainsi à propos de l’amitié : « Les
amitiés se nouaient directement, sans rien de ces embarras qui paraissaient
jadis indispensables, et une fois qu’elles existaient elles dépréciaient
toutes les autres » (Michael Herr[a]). « Vivre
dans une zone de guerre, c’est vivre intensément ; les amitiés
sont plus fortes, l’amour plus profond, la peur plus intense. »
(Ted Bartimus[c], journaliste à l’Associated Press au Vietnam
en 1973). « Cette guerre, avec ses dangers et ses morts, fut une
véritable histoire d’amour. Le Vietnam révéla un sentiment
sublime. Une amitié forte est une chose rare sauf en situation de
guerre où le sentiment de fraternité et d’amitié s’intensifie.
C’est un contrepoint aux horreurs et aux épreuves de la guerre.
Nous étions très loin de chez nous et enchantés de
découvrir un monde d’une telle richesse. Je n’ai jamais ressenti
une émotion aussi intense depuis. » (Pierre Schoendoerffer[c]).
Cette intensité attire le journaliste qui quitte la paix pour aller
vers la guerre, et lui fait perdre ses repères : Jean Hatzfeld évoque
une compagne qui lui annonce, à Paris, qu’elle le quitte : « Je réalise que la tendresse que j’ai dilapidée à Vokovar
ou dans les hameaux démolis, pour surmonter la détresse imprimée
sur les visages, vivants et morts, que je rencontrais, toute cette tendresse
lui était destinée, et je l’en ai privée. La guerre
prend toujours plus qu’elle ne donne. »[b]
Car elle donne. Paul Marchand marche sur la célèbre Sniper
Alley à Sarajevo, et c’est encore Jean Hatzfeld qui raconte : « Soudain le ciel se déchira avec une telle violence au-dessus de
sa tête qu’il plongea dans la neige ouatée d’un remblai. Il
s’allongea confortablement sur le dos pour regarder. Dans un vacarme d’explosions,
il assista à un feu d’artifice qu’il qualifie de féerique
: les combattants des deux rives illuminaient la rivière avec des
rafales de balles traçantes qui formaient au-dessus de l’eau un
immense accent circonflexe multicolore. C’était la nuit du Jour
de l’An 1993. »[b]
Parfois les guerres s’arrêtent. Ça a été
le cas au Vietnam : « De nouveau dans le Monde, et beaucoup d’entre
nous n’y arrivent pas. L’histoire a vieilli ou nous avons vieilli. [...]
Quelques cas extrêmes pensaient que cela avait été
une expérience glorieuse, la plupart d’entre nous trouvaient simplement
que c’était merveilleux. Je crois que le Vietnam est ce que nous
avons eu à la place d’une enfance heureuse. » (Michael
Herr[a]). Parfois les guerres arrêtent les journalistes, ainsi
Jean Hatzfeld, grièvement blessé à la jambe : « Une année s’est écoulée depuis cet après-midi.
Une année passée à l’hôpital, au lit, au centre
de rééducation ; à transpirer au bois de Vincennes,
à soulever des poids dans un gymnase, à réapprendre
à marcher dans la salle d’exercice au dallage blanc d’une clinique.
Douze mois [...] à réapprendre à dormir, à
récupérer les réflexes de conduite en voiture, à
m’exercer à porter mon sac. Pour revenir ici. »[b]
Repartir, revenir : ici, sous les bombes.
§
Aimer la guerre ? Michael Herr raconte que Tim Page, photographe gravement
blessé au Vietnam, reçut un jour une lettre d’un éditeur
lui proposant d’écrire un livre intitulé Fini la guerre et
ayant pour but d’ôter « une fois pour toutes tout prestige
à la guerre ». Tim Page rigole : « La guerre
vous fait du bien, on ne peut pas enlever tout attrait à ça.
C’est comme de vouloir enlever son attrait au sexe, ou aux Rolling Stones.
[...] Quelle idée ! Que c’est drôle ! Enlever son foutu
charme à une foutue guerre ! »
Pour comprendre ça, ce charme, comprendre que la guerre est
belle, vous n’avez qu’à regarder ces images qu’ils sont allés
filmer, photographier, pas des images montées comme on les voit
à la télé, une caméra qui tourne sans s’arrêter
dans Grozny bombardéee, vous voyez ces immeubles qui s’illuminent
en orange, vous êtes comme eux, comme ces journalistes, vous êtes
dans la guerre, vous n’êtes plus dans votre salon, vous comprenez
ce qui les attire, vivre autre chose que leur vie, vivre un cauchemar qu’ils
se sont choisi, mais qu’ils sont libres d’interrompre quand ils le veulent,
vous voyez ces petites lumières vertes régulières
qui partent vers le ciel, et à ce moment ça y est vous comprenez
et vous pensez j’aime la guerre.
Raphaël Meltz